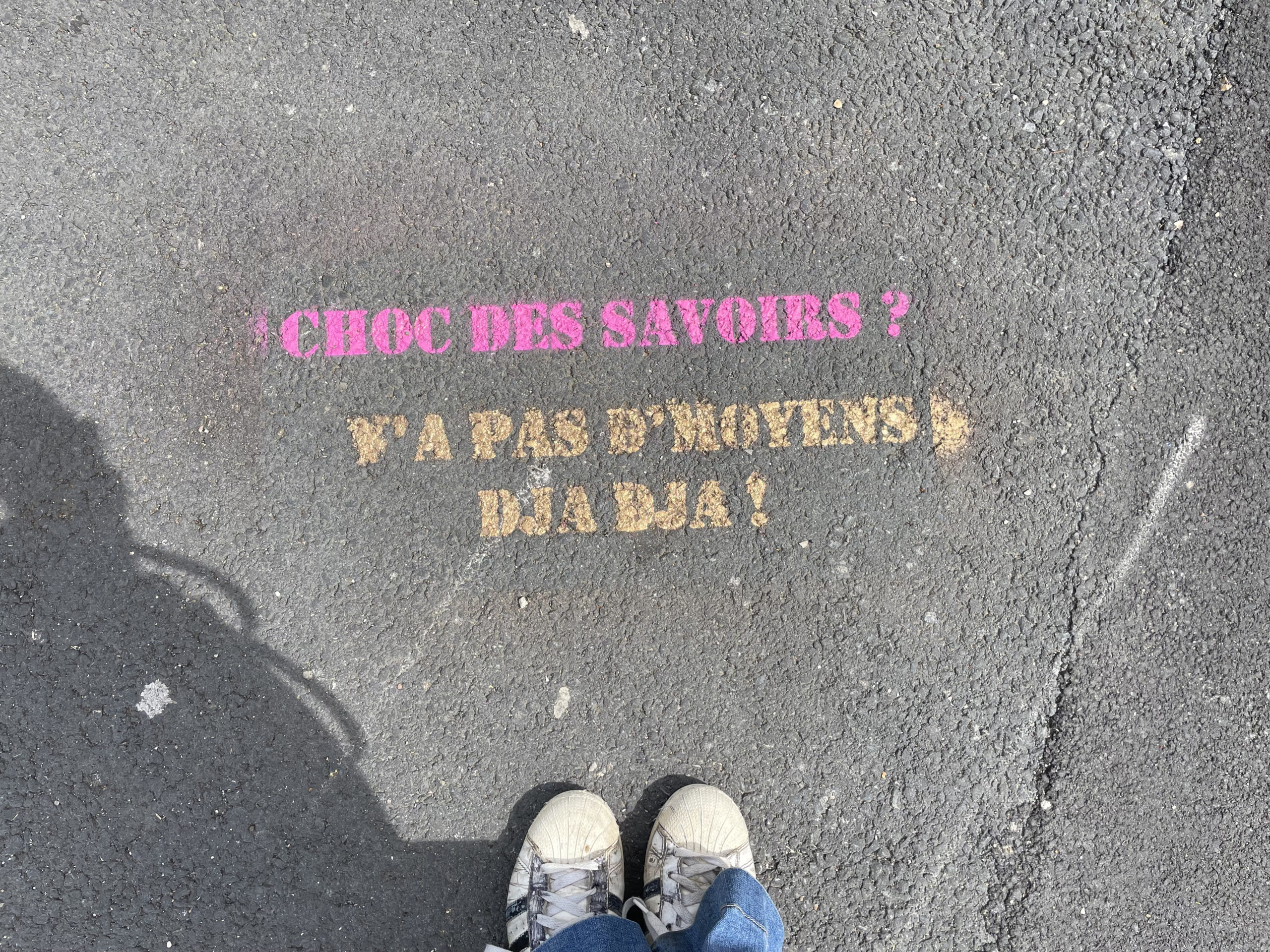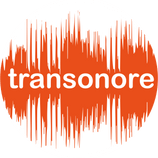En ce début de mois d’août, le soleil cogne contre le sol bétonné. Je descends prudemment les marches métalliques qui mènent à la Seine, au point de baignade aménagé à Bercy. L’eau est fraîche, un peu trouble, mais je n’hésite pas. Autour de moi, l’agitation parisienne s’efface peu à peu. Le bruit des voitures et le tumulte des passants s’atténuent, remplacés par le clapotis de l’eau et les rires des nageurs.
En levant les yeux j’aperçois la bibliothèque François Mitterrand, une sensation presque d’irréalité m’envahit. Nous sommes quelques dizaines à nous laisser flotter, portés par le courant, à nager et à rigoler (en essayant de ne pas boire la tasse quand même). La plupart sont des touristes, smartphones à la main pour instagrammer ce moment buissonnier. Une expérience pittoresque, une anecdote à raconter à leur retour. Mais pour celles et ceux, comme moi, qui vivent dans cette ville, c’est bien plus qu’un plaisir estival.

Les baignades dans le fleuve emblématique de Paris, interdites depuis 1923, sont devenues une nécessité face aux canicules répétées. Chaque vague de chaleur rappelle le manque d‘îlots de fraîcheur accessibles pour les habitant.es. Les piscines municipales saturées et payantes, les parcs encombrés, les fontaines prises d’assaut… Dans ce contexte, la Seine redevient un refuge vital, un lieu d’apaisement et de survie.
Ouvrir des zones de baignade sécurisées – et gratuites – est un premier pas. Alors que je finis par oser me mouiller jusqu’au cou, je ne peux pas m’empêcher de me demander pourquoi il a fallu attendre les JO pour redonner aux habitant.es un accès direct à leur fleuve ? Historiquement, la Seine a toujours été au cœur de la vie parisienne, mais la pollution et les politiques urbaines l’ont progressivement rendue inaccessible. Aujourd’hui, la lutte contre le réchauffement climatique et l’urbanisation accélérée nous imposent de repenser notre rapport à la nature et au vivant en ville. Je pense à ce procès fictif sur les droits de la Seine, porté par la mairie de Paris en décembre dernier, et à la Déclaration des Droits de la Seine, initiée par l’ONG Wild Legal.
Nager dans la Seine est un acte militant. Une manière de revendiquer notre droit à la fraîcheur, à la détente, à la convivialité dans un espace public souvent trop bétonné, bruyant, pollué. C’est aussi un appel à la responsabilité collective pour préserver la santé d’un fleuve essentiel.
En remontant sur la berge, je me dis que cette baignade a un goût de liberté retrouvée mais aussi d’urgence. L’eau, loin d’être un simple décor touristique, pourrait redevenir le cœur battant d’une ville qui apprend enfin à vivre avec son fleuve.
La baignade dans la Seine n’est plus une utopie. Trois sites naturels — bras Marie, Grenelle et Bercy — accueillent les nageurs depuis le 5 juillet. Et deux d’entre eux joueront les prolongations : jusqu’au 7 septembre à Grenelle, et au 14 septembre à Bercy. La Marne aussi retrouve ses baigneurs. Interdite depuis cinquante ans, elle est de nouveau ouverte à la baignade à Maisons-Alfort, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés et Champigny-sur-Marne. Il est également possible de se baigner dans le Canal Saint-Martin au niveau de la Passerelle Bichat, Bassin des Récollets ainsi que dans le bassin de la Villette jusqu’au 31 août.
Mais cette révolution aquatique ne doit pas faire oublier la vigilance : entre le 1er juin et le 13 août, 39 noyades ont été recensées en Île-de-France. Si le chiffre reste stable, le nombre de décès augmente, atteignant 41 % des cas cette année, selon Santé publique France. Pour prévenir ces drames, plusieurs communes s’appuient sur le programme “J’apprends à nager”, destiné à familiariser les plus jeunes avec l’eau.
Likez, partagez, commentez
À consulter également

14 novembre 2025 - Alimentation durable
La cueillette du potager
Par Gaïa M'Fah-Traoré

9 octobre 2025 - Portrait
Portraits de profs engagés – William Ajenjo: Enseignant du vivant
Par Camille Xiong

15 septembre 2025 - Pantin
« La meilleure salle de classe n’a pas de murs »
Par Joséphine Teillet