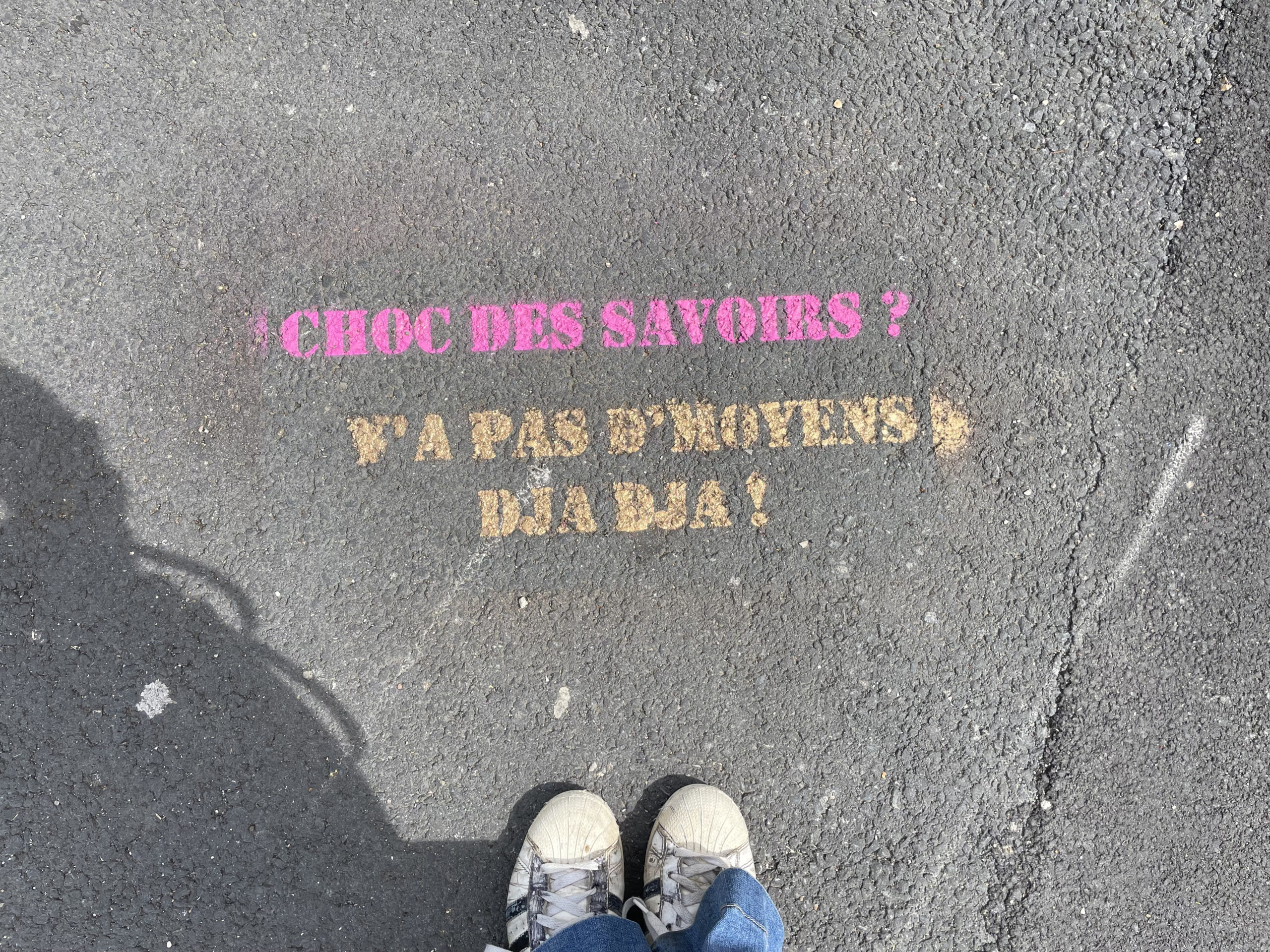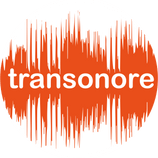Ancienne professeure de physique-chimie en Algérie, Ouahiba est arrivée il y a seize ans en France. Aujourd’hui éco-animatrice à la cité maraîchère de Romainville, en Seine-Saint-Denis, elle a gardé de son ancien métier l’amour de la transmission. Portrait.
Derrière les grilles du jardin partagé des Méditations, au Pré Saint-Gervais, le calme tranche avec l’agitation de la ville. Des bacs en bois débordent de fleurs en pagaille, de thym, de verveine citronnée, de romarin. Ouahiba s’y affaire en silence. Elle sourit, les pommettes légèrement rosées : “ C’est ici que je me sens le mieux. Je n’ai pas de balcon, alors c’est mon bol d’air.”
Arrivée d’Alger en 2009, Ouahiba a connu un déracinement brutal. Là-bas, elle était professeure de physique-chimie depuis près de trente ans. En France, à 45 ans, elle est repartie de zéro. “ J’ai tout laissé : mon métier, mes amis, ma vie. Je suis venue pour suivre mon mari mais je ne voulais pas partir.” se remémore-t-elle. L’atterrissage est rude. “ Le Pré Saint-Gervais n’avait aucun espace vert. J’étais comme en cage.” soupire-t-elle.
Après avoir travaillé plusieurs années comme assistante maternelle, elle se tourne vers la vie associative. Elle fréquente notamment le Café Culturel du Pré, comme on surnomme la petite commune de Seine-Saint-Denis limitrophe du 19e arrondissement de Paris. Cette association, créée par Aneta Szynkiel, une metteure en scène qui veut favoriser l’accès à la culture pour aider les femmes à s’autonomiser, l’ouvre à d’autres possibles. Elle s’investit, discute, découvre. « J’ai compris que je voulais faire quelque chose d’utile et de collectif. » explique-t-elle.

Un jour, elle entend parler du Sens de l’Humus, une association qui mêle agriculture urbaine et éducation populaire. Ouahiba y suit une formation gratuite, une immersion d’un mois et demi sur un terrain de 600 mètres carrés, situé aux Murs à Pêches à Montreuil. Une révélation. « J’ai appris à faire du compost, à tailler, à semer, à faire des boutures. Ça m’a fait un bien fou. » Ce qu’elle croyait inaccessible devient un terrain d’action. « On pense qu’il faut être expert mais non. Il suffit d’observer. De donner un peu d’attention, c’est comme avec les enfants ! » rigole-t-elle.
Depuis quelques mois, Ouahiba travaille à la Cité Maraîchère de Romainville comme éco-animatrice. Elle anime des ateliers sur différents sites : la ferme des Petits Monstres, la corniche des Forts, l’ancien site de la cité Gagarine. Partout, elle accompagne les habitant·es dans leurs débuts de jardinier.es. « Je leur montre comment planter, faire des tuteurs, comprendre les saisons. Certains n’y connaissent rien, mais ils ont envie. Et moi, j’adore transmettre. » explique-t-elle. Transmettre, toujours. Dans son ancien métier d’enseignante, c’était la base : « J’aimais expliquer, aider les élèves à comprendre. Ici, c’est pareil mais avec la terre. Ça passe par les mains. » Pour elle, le jardinage est un prétexte au lien, un espace où chacun peut reprendre confiance. « Les gens ont souvent peur de mal faire. Je leur dis qu’il n’y a pas d’erreurs, juste des expériences. » dit-elle en se servant un verre d’eau.
Ouahiba applique cette philosophie à son propre parcours. Chaque nouveau projet est une étape vers une forme de réancrage. Tout ce qu’elle peut faire de ses mains, elle le fait. Pas par fierté, mais par nécessité intérieure. « Je ne veux pas dépendre des autres pour faire les choses,” affirme-t-elle. Dans le jardin des Méditations, elle a installé plusieurs bacs pour inviter à jardiner. Elle espère que d’autres habitant·es s’en empareront. « Pour l’instant, ils n’osent pas trop. Mais peut-être à la rentrée. Je ne force personne. J’essaie juste de montrer que c’est possible. »
Quand elle ne travaille pas, elle vient ici presque tous les jours. Elle observe, arrose, taille. Parfois, elle parle à ses plantes de sa voix douce et chaleureuse. Ce petit coin vert est devenu son refuge. Une manière de se reconnecter à soi, aux autres, à la nature. En treize ans, Ouahiba a redessiné sa place. Déracinée d’un pays, elle s’est enracinée autrement : dans la terre, les rencontres, les projets partagés. Son histoire illustre tout ce que l’agriculture urbaine peut offrir. Bien plus que des légumes. La vie.

Likez, partagez, commentez
À consulter également

14 novembre 2025 - Alimentation durable
La cueillette du potager
Par Gaïa M'Fah-Traoré

9 octobre 2025 - Portrait
Portraits de profs engagés – William Ajenjo: Enseignant du vivant
Par Camille Xiong

15 septembre 2025 - Pantin
« La meilleure salle de classe n’a pas de murs »
Par Joséphine Teillet