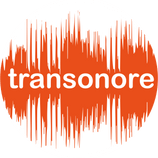Sur un terrain caché, sur les hauteurs de Baratier, commune de 626 habitants des Hautes-Alpes, Sébastien Haffa, jardinier, propose aux habitant.es de venir cueillir leurs propres légumes. Notre reporter a profité d’un séjour dans la région cet été pour lui rendre visite.
Pour manger bio à Baratier lorsqu’on n’a pas son propre potager, il y a 2 solutions : acheter des légumes dans un supermarché bio ou aller les chercher directement dans la terre chez Sébastien.
Dans le village, des pancartes nous invitent à monter un sentier ombragé. Après quelques minutes d’effort, alors que le paysage se dégage, la liste des légumes du moment et un message nous accueillent: “Bienvenue à la Cueillette du Potager. Légumes Bio Cat. II”.

C’est ici, sur ce terrain isolé, que Sébastien cultive fruits et légumes depuis maintenant six ans.
Surnommé Monsieur Tomate, grâce au goût de celles qu’il fait pousser, ce photographe accueille ses nouveaux.elles client.es avec une présentation du potager avant de les aider à cueillir leur prochain repas eux-mêmes !

Un lieu né du hasard
Lorsque Sébastien décide de reprendre la terre de son père, en 2019, alors qu’il vit à Paris, il prévoit d’y planter un verger de noisetiers et le conçoit alors plus comme une activité secondaire. Mais l’année suivante, le confinement l’amène à rester dans la région plusieurs mois et son projet prend une tournure différente.
Une fois les noisetiers en terre, il faut attendre six ans avant les premières récoltes, Sébastien s’occupe en créant un petit potager, avec dans l’idée “d’inviter les gens à récolter leurs légumes frais.” Chez Sébastien, l’expression “du producteur au consommateur” prend vie et se veut aussi pédagogique.
Dès la première année, les gens sont si nombreux à venir jusqu’à lui que le potager est constamment vide. “[Ils] me soutenaient parce qu’ils appréciaient le fait de pouvoir cueillir et la véracité du produit.” Cette année encore, ses clients en témoignent.
La cueillette à tous les âges
Une famille lyonnaise qui vient souvent en vacances dans la région raconte avoir découvert cette exploitation par hasard. “Les enfants adorent”, souligne le couple. C’est une façon ludique de découvrir d’où proviennent leurs aliments. Quant aux adultes, la vue panoramique sur les montagnes et la passion transmise par le jardinier ne font qu’ajouter à l’expérience.

Sébastien vend aussi une partie de sa production à l’enseigne Biocoop. Et quand il reste des légumes, ils sont donnés au Secours populaire.
Une communauté de jardiniers
Son terrain accueille également 6 parcelles partagées par des familles voisines. Les familles baratonnes y font pousser leur propre potager et, en cas de besoin, quelqu’un est toujours disponible pour donner un coup de main à Sébastien.
Les jardinier.es amateur.ices peuvent ainsi apprendre des techniques de l’exploitation biologique tandis que leurs différents goûts ont pu inspirer le jardinier. “On voit un peu la personnalité de chacun”, se réjouit-il en faisant le tour des potagers familiaux.
Une des familles, par exemple, a fait le choix de conserver une bute déjà présente au lieu de l’aplanir comme la plupart des jardiniers. Leur potager à plusieurs niveaux, en plus d’être joli, “[respecte] le terrain sans vouloir le transformer”, souligne le jardinier. Un autre jardinier, “l’artiste” comme le surnomme Sébastien, tisse lui-même des palissades de branches dans son potager.

Le défi de la permaculture
L’exploitation de Sébastien se démarque également par le choix de la permaculture, une agriculture qui s’inspire des cycles naturels pour être la plus durable possible. En pratique, le jardinier ne fait pousser que du bio, ne se mécanise pas et ne laboure pas sa terre.
Cette approche n’est pas sans défis, en particulier sur un terrain d’un hectare entretenu par une seule personne. Mais pour Sébastien, c’est une opportunité. Il a depuis longtemps fait le choix du bio, sensibilisé à la question pendant ses études. Au-delà de remplacer les produits chimiques par des méthodes naturelles, s’agit d’apprendre à faire l’agriculture autrement. “Faire du bio, c’est aussi accepter que les plantes soient moins productives, accepter la perte.”
Sébastien nous explique que travailler presque sans machines lui assure une certaine indépendance, en termes d’énergie et de réparations potentielles. Pour assurer le labourage, une bâche posée sur le sol lui suffit. La couverture du sol encourage le travail des lombrics, des racines et du reste de la “vie du sol” qui laboure à la place des machines. Même si la bâche est autorisée en agriculture bio, Sébastien aimerait à terme la remplacer par un système de lasagnes: un empilement de différents types de biomasse (feuilles, paille, excréments etc.).
Pour y parvenir, il voudrait produire cette biomasse juste à côté de son exploitation, dans une forêt agricole, aussi dite forêt comestible, en plantant différentes plantes par “niveaux” qui pourraient s’entraider les unes les autres. Les arbres fruitiers, par exemple, produisent des feuilles très utiles pour faire des lasagnes ou de l’engrais.
Chez Sébastien, pas de machines donc mais des chevaux qui broutent les herbes du terrain une fois par an, ainsi que des poules qui parcourent le terrain, à la recherche d’insectes. “Les chevaux sont mon désherbant et les poules mon insecticide” nous explique-t-il.

Pour une “agriculture sauvage”
Et parce que Sébastien n’a jamais fini d’apprendre, il s’intéresse aussi à “l’agriculture sauvage”. Ce terme, qu’il emprunte à Masanobu Fukuoka, considéré comme un précurseur de la permaculture, désigne une philosophie de la non-intervention en agriculture fondée sur une autre vision du rapport entre l’humain et la nature. Ce jardinier japonais préconise notamment la non-intervention pour combattre la désertification causée par les méthodes d’agriculture intensive qu’il observe dans les années 70-80. À l’origine cependant, l’idée du “sauvage” repose sur un rejet de la conception occidentale qui voudrait que la nature soit outil de l’homme. Fukuoka place l’humain comme un composant de celle-ci et rejette les avancées technologiques agricoles qui mettraient la nature au service de la technique.2
Pour Sébastien, cela se traduit pour l’instant par une serre d’expérimentation au fond de son terrain, où poussent des tomates à même le sol. Il s’agit de “laisser vivre le pied de tomate tranquillement sa vie”, nous explique t-il face à un plant. Il interroge le sur-arrosage, la taille et le tuteurage. Arroser constamment une plante , c’est, pour lui, un peu comme “nourrir un être humain de force”, dans le seul but qu’ils soient plus grands. Pourquoi ne pas “laisser le légume vivre” et accepter qu’il soit plus petit, qu’il murisse plus tard dans la saison ? Dans cette serre, les tomates rampent sur le sol et sont arrosées uniquement quand leurs feuilles flétrissent.
Malgré tout, “le non-interventionnisme ne veut pas dire le non-agir”, précise le jardinier. L’idée est plutôt d’accompagner la plante, pour qu’elle ne tombe pas malade, notamment du mildiou pour la tomate.

De 30 familles à 60 millions?
Alors que nous buvons un sirop sur la terrasse, Sébastien évoque la loi Duplomb, fraîchement adoptée par l’Assemblée Nationale. Pour lui, le problème, ce sont les grosses surfaces mécanisées, qui ont recours aux pesticides et aux insecticides. pour nourrir une grande partie de la population”. Néanmoins, il est conscient de ne pouvoir nourrir que “30 familles dans l’année” alors que l’on est “quand même plus de 60 millions en France.”
“Ce qu’il faut faudrait, c’est (…) qu’il y ait plein de petites exploitations agricoles de 1 à 3 hectares, à taille humaine, non mécanisées” , explique-t-il. En somme, des exploitations qui favorisent l’agriculture bio et durable ainsi que le circuit court.
Après une séance de cueillette au potager, on ressent une certaine émulation. En plus de nourrir les familles du coin avec des légumes bio à des prix abordables (les courgettes sont vendues entre 1€ et 2,80€ par exemple), d’éduquer et de créer du lien, un potager comme celui de Sébastien favorise une agriculture durable. Un terrain de partage et d’expérimentation pour une agriculture plus respectueuse et une alimentation plus juste.
Si vous passez par Baratier, n’hésitez pas. Il suffit de suivre les pancartes !
(PS : Et pour les mains vertes, Sébastien est en recherche de 2 stagiaires d’avril à septembre !)

Article écrit par Gaïa M’Fah-Traoré avec l’aide de Laure Watrin.
Sources
1 Mairie de Baratier. En ligne : https://www.baratier.net/ [consulté le 8 août 2025].
2 Yuriko, Yoneda. « Natural Farming Greening the Deserts: Japanese Farmer-Philosopher Fukuoka Masanobu », Asia-Pacific Journal. janvier 2007, vol.5 no 1. p. e24.
Likez, partagez, commentez
À consulter également

9 octobre 2025 - Portrait
Portraits de profs engagé·es – William Ajenjo: Enseignant du vivant
Par Camille Xiong

15 septembre 2025 - Pantin
« La meilleure salle de classe n’a pas de murs »
Par Joséphine Teillet
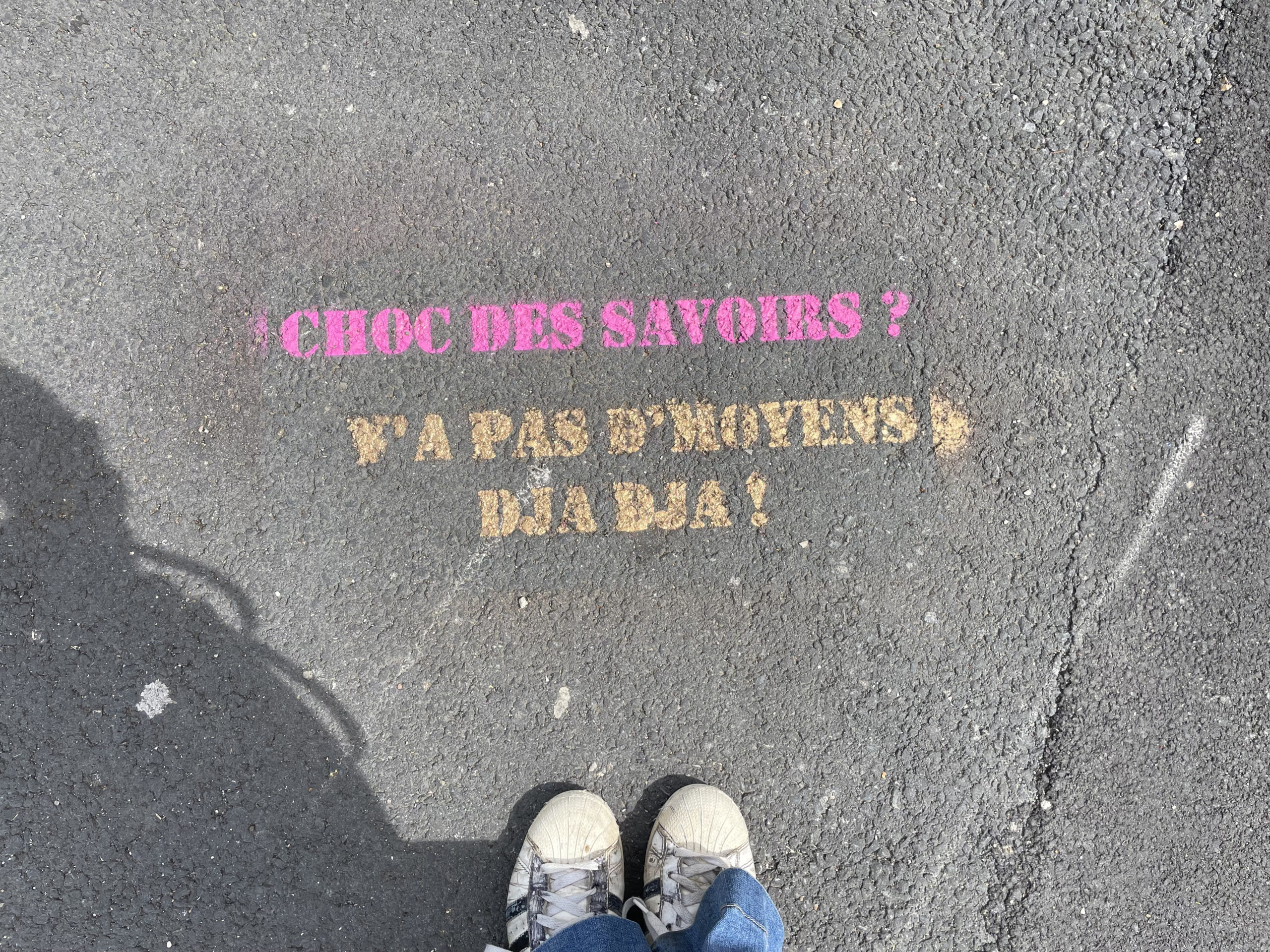
1 septembre 2025 - Seine-Saint-Denis
Choc d’égalité pour le 93
Par Laure Watrin